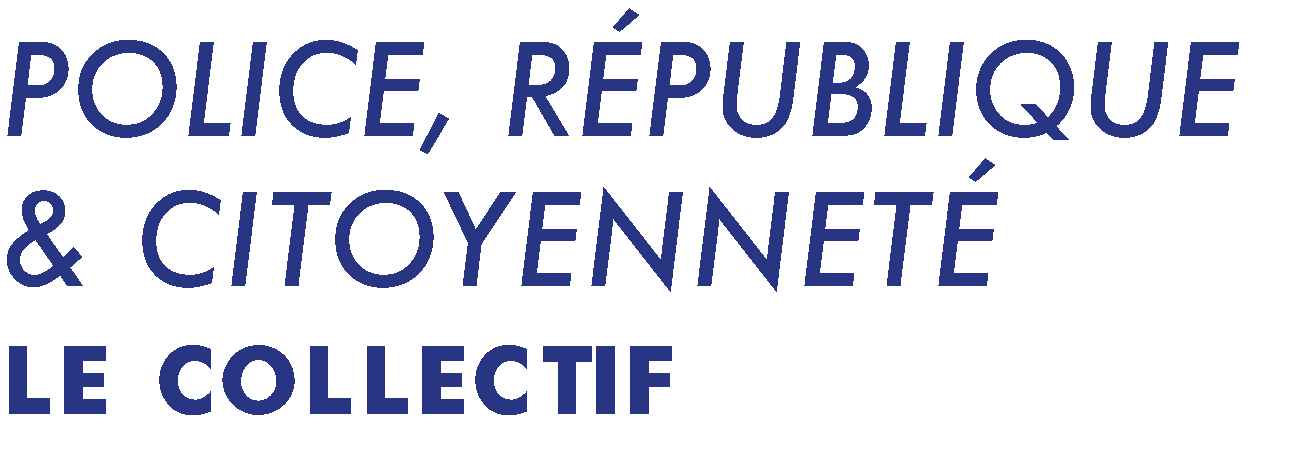Le 13 février 2013, le dernier congrès du SGP.
Le 13 février 2013, le syndicalisme policier est devenu orphelin. Ce jour-là, s’est tenu le dernier congrès du SGP, qui a décidé et entériné sa dissolution, un an avant de fêter son centième anniversaire.
Ce syndicat, notre syndicat disparaît donc de la scène, il tire sa révérence dans, il faut bien le reconnaître, une certaine forme « d’indifférence ».
Je ne porterai aucun jugement tant sur la forme que sur les conditions qui ont mené à cette disparition.
Je laisse tous ceux qui y ont participé, devant leurs choix personnels, qu’ils soient politiques ou stratégiques, et devant éventuellement leur conscience de « militant… »
Cette dissolution entraîne un véritable bouleversement dans le paysage syndical et laisse pour beaucoup de militants actifs ou retraités un sentiment de vide, d’abandon et d’amertume et pour ma part beaucoup de colére.
Né en 1924 de la transformation d’une association créée en 1911, (l’Association Générale Professionnelle du Personnel de la Préfecture de Police) elle-même issue du « Comité des Réformistes » au début des années 1900.
Il s’agit de la plus ancienne marque syndicale qui disparaît aujourd’hui.
Entré en 1893 à la PP, en tant que gardien de la paix, Paul Rigail exerce alors dans les 18 éme, 12 éme puis 20 éme arrondissement où il s’installe définitivement en 1897. Contrairement à nombre de ses contemporains, anciens soldats et sous-officiers, qui sont entrés à la PP à l’issue de leur engagement, il est l’incarnation d’une nouvelle génération de policiers qui vont faire carrière dans la police.
Issu d’une famille parisienne, d’une mère institutrice, il peut faire état d’une compétence scolaire et technique supérieure à la moyenne, marquée par la réussite au certificat d’études primaires. Il est en 1906, un vrai professionnel de la police en tenue et en tant que sous brigadier il est un pilier du commissariat central du 20 éme arrondissement.
Présenté par beaucoup de syndicalistes et d’observateurs extérieurs spécialistes du monde syndical policier comme le « fer de lance » du syndicalisme policier, le SGP a vu émerger les plus grandes figures historiques tels en tout premier lieu bien sûr : Paul RIGAIL, mais aussi Noël RIOU, François ROUVE, Jean CHAUNAC, Gérard MONATE, Bernard DELEPLACE,Richard GERBAUDI et Jean-Louis ARAJOL.
Affilié à la FASP depuis sa création en 1969, le SGP a fourni à cette structure nationale ses leaders les plus marquants.
Tous ces militants, ont été nourris et élevés dans un idéal forgé par des années de luttes et de combats syndicaux.
Le SGP, par ses pères fondateurs s’est construit sur l’importance des principes républicains. Défendus tant auprès de ses propres adhérents qu’auprès des syndicats concurrents, cette volonté est contenue dans cette affirmation : « La Police Républicaine est et doit être neutre, elle est au service de l’Etat, de la République et de tous les citoyens, pas d’un gouvernement particulier ni même d’une classe sociale ».
Voilà en ces termes, la véritable marque de fabrique du SGP.
Malgré toutes les difficultés liées notamment à l’organisation particulière des services de police, placés sous la férule autoritaire et autocratique des Préfets de police, les fondateurs du SGP ont eu le courage de déclarer que les policiers étaient eux aussi des travailleurs avec des problèmes corporatistes, matériels et moraux spécifiques.
Début 1900, le travail des policiers ne semble intéresser personne, pas plus leurs conditions de travail, leurs problèmes professionnels ou matériels et les revendications qui en découlent.
Malgré une hostilité déterminée du préfet de Police de l’époque, qui n’hésitait pas à utiliser la révocation comme outil de répression, c’est dans un contexte où le mécontentement est de plus en plus présent ; répartition injuste des services payés, horaires de travail insupportables, punitions fréquentes, que sous l’impulsion de RIGAIL les agents de la PP ont accepté de se défendre contre la brutalité et l’arbitraire administratif.
Le 1er décembre 1906, suite à une circulaire du préfet, modifiant la répartition des services payés, plus de 2000 gardiens de la paix tiennent, à l’appel du Comité des réformistes présidé par RIGAIL le tout premier meeting de contestation.
De plus, les gardiens présents décident de désigner deux délégués par arrondissement, qui seront chargé d’élaborer et de présenter à l’administration un cahier de revendication.
Il s’agit là d’une véritable révolution dans une institution où les personnels étaient plutôt, par force et par crainte, enclins à courber l’échine et baisser la tête.
RIGAIL avec quelques camarades courageux, malgré les menaces, les pressions exercées tant sur eux-mêmes que sur leurs épouses et leur famille, ont réussi ce jour-là l’impensable ; restaurer la dignité des policiers parisiens. Relever la tête, ne plus subir, s’unir pour faire valoir leurs maigres droits.
Les bases du futur SGP ont été jetées. Dans tous les services de la Préfecture de police, des délégués désignés par leurs pairs, chargés de prendre en compte leurs demandes et de les formaliser dans un cahier de revendications qui sera l’expression d’une véritable émanation collective.
Pendant de nombreuses années, cette manière de faire, voulue par les fondateurs, a été la marque du SGP.
On peut également mesurer l’influence du syndicalisme policier de RIGAIL à l’extérieur de nos frontières, le mouvement syndical policier parisien fait preuve d’une grande antériorité en Europe et il semble avoir eu valeur d’exemple pour les policiers d’autres pays, ce fut le cas notamment pour le mouvement qui toucha la Metropolitan Police de Londres en 1918-1919. L’action de RIGAIL longuement commentée dans leur presse professionnelle, ne fut pas sans influence sur les revendications des policiers londoniens et sur les deux grèves qu’ils menèrent alors.
Au travers de ces rappels historiques, on mesure l’importance et l’influence que pouvait représenter le SGP.
On a vu plus haut dans cette présentation, que les revendications portaient naturellement sur les salaires, les retraites, les horaires, les conditions de travail, mais Paul RIGAIL tenait également à faire porter par le SGP une revendication morale.
La soif de considération, la volonté d’obtenir la reconnaissance de leur rôle sont constamment présentes dans l’action syndicale menée par les délégués.
Cette demande de reconnaissance se traduit quelquefois par des revendications politiques, qui prennent parfois un aspect antihiérarchique chronique. S’il n’y a pas de grands changements dans l’attitude et le comportement des gardiens de la paix sur le terrain, ce sont ces mêmes policiers pour la plupart francs-maçons, qui ont créé l’union des réformistes et qui ont réfléchi aux conséquences et implications politiques de leur comportement et surtout à l’usage que l’on faisait d’eux dans le maintien de l’ordre.
Si les sergots recrutés dans l’armée impériale n’avaient dans les années 1880, qu’un souci modéré des conséquences de leur violence pour le régime qui les employait et du discrédit qui en résultait pour la République et surtout pour les classes populaires victimes ordinaires de ces violences, les réformistes dénoncèrent ce rôle de chiens de garde des riches, de défenseur du capitalisme qu’on leur faisait jouer.
C’est ainsi qu’on vit les membres de l’Association Générale de la Police, RIGAIL en tête dénoncer les violences, les brutalités de certains de leurs collègues et incriminer tout à la fois les consignes données, les officiers de paix et la haute hiérarchie préfectorale.
Ces réformistes osent à l’époque dénoncer l’incapacité de leurs chefs et le rôle qu’on leur faisait jouer par l’emploi systématique de la police au service de la bourgeoisie contre les travailleurs.
Ils osent dénoncer les officiers de paix hostiles à la république qui dressent leurs agents contre la classe ouvrière, ordonnent la charge contre les manifestations populaires, mais qui sablent le champagne avec les organisateurs des manifestations politiques antigouvernementales ou réactionnaires.
Sincèrement républicains, ils pressentent les dangers d’une telle situation, le fossé qui sépare la population de sa police est de plus en plus présent, jetant le discrédit sur le régime gouvernemental. C’est au nom de leurs convictions et de l’idée qu’ils se font de la république et d’une police républicaine au service de tous, qu’ils demandent à la hiérarchie et aux gouvernements, par l’intermédiaire de la presse, par des motions, des pétitions auprès des parlementaires et des élus, de cesser de les employer systématiquement contre les travailleurs et de permettre à la police d’observer une réelle neutralité dans les conflits économiques et sociaux de l’époque.
Dans le même temps, Paul RIGAIL l et ses amis demandent à leurs collègues de se comporter différemment. Un énorme travail pédagogique, embryon d’une certaine forme de formation syndicale, se met en place pour donner aux gardiens de la paix une plus haute idée de sa fonction, de son rôle, de sa dignité et de ses responsabilités mais aussi de son importance et de sa force.
Paul RIGAIL avait compris que les gardiens de la paix, qui ne sont ni tout à fait des ouvriers, ni tout à fait des militaires, mais un mélange des deux, n’acceptaient plus l’image réductrice qui ne faisait d’eux qu’un instrument de l’ordre et du pouvoir.
Il a réussi à créer un syndicalisme, né de la mutualité et de l’amicalisme, acceptant les principes de la lutte politique au service d’une certaine idée de la république.
La police républicaine telle que la voulait Paul RIGAIL, est au service de tous et elle combat les désordres d’où qu’ils viennent car son objet est et doit demeurer : la défense des libertés, de toutes les libertés.
Le monde policier constitue une société avec ses règles, ses codes, ses valeurs, ses revendications, son langage et constitue une famille avec ses problèmes, ses divisions, ses amis et aussi ses solidarités.
Le syndicalisme tel que l’espérait Paul RIGAIL c’est aussi une vie associative bien traditionnelle et bien vivante. Une vie associative qui constitue une source de solidarité peut-être plus forte que les divisions.
Voilà en ces termes, ce qui à mes yeux est la véritable marque de fabrique du SGP.
Avons-nous réussi à préserver cet idéal. Avons-nous réussi à faire fructifier cet héritage. Je ne saurai et ne pourrai répondre à ces questions. Je laisse à chacun d’entre vous le choix d’apporter ou pas une réponse.
Discours de Pierre BARGIBANT
Assemblée Général de l’AGRPN du 4 Avril 2013