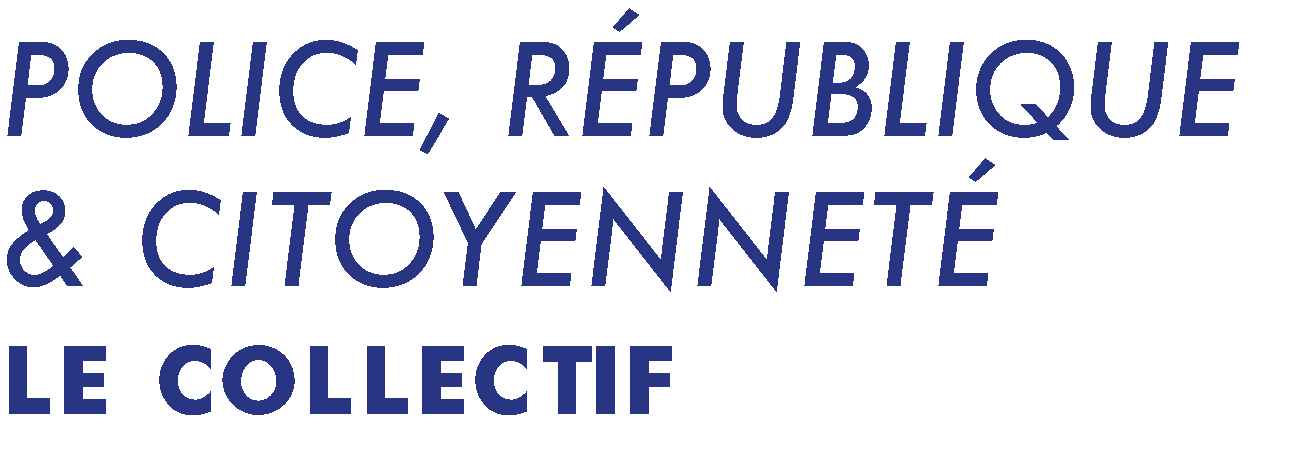« Narcotrafic, un ennemi commode »
Extrait du magasine « le Monde diplomatique »
Novembre 2025
Sitôt nommé, le nouveau ministre de l’intérieur français, M. Laurent Nuñez, ancien préfet de police de Paris, a annoncé que la « guerre contre les narcotrafiquants » serait une de ses deux priorités. Ce thème suscite des discours de plus en plus affolés, sur fond d’analogies avec l’Amérique latine. La question de la demande croissante de drogues semble moins passionner que la chasse aux pourvoyeurs.
PAR LAURENT BONELLI, membre de « l’Observatoire de la sécurité «
«NON seulement le crime est normal, mais il est facile de prouver qu’il a bien des utilités. » À l’heure où le « narcotrafic »semble être devenu l’un des principaux fléaux de la société française, cette formule de Karl Marx, tirée d’un texte rédigé au début des années 1860, mérite qu’on s’y attarde (1). Prenant le contrepied de la criminologie de l’époque, portée à percevoir la délinquance comme une pathologie (sociale ou mentale), l’auteur suggère en effet qu’elle serait consubstantielle à la vie collective. Une piste explorée plus systématiquement par Émile Durkheim : le sociologue montrera quelques années plus tard que le regroupement de certains actes ou comportements sous la catégorie de « crime » sert à fixer les frontières morales d’une société, en séparant une majorité d’« honnêtes hommes » d’une minorité de « criminels » (2). Mais Marx a une intuition supplémentaire lorsqu’il s’interroge sur les « bénéfices secondaires » de cette criminalité, c’est-à-dire sur l’ensemble des activités (le droit, la littérature, la presse, la science, la technique) et des professions (policiers, avocats, assureurs, serruriers, etc.) qui prospèrent grâce à son existence. La liste qu’il dresse n’est pas exhaustive et on pourrait y inclure aujourd’hui la plupart des élites politiques et médiatiques, depuis qu’elles ont fait de la sécurité l’un de leurs thèmes de prédilection. Amorcé aux États-Unis au début des années 1970 sous l’étiquette « loi et ordre » (« law and order »), ce mouvement se déploie une trentaine d’années plus tard de l’Europe à l’Amérique latine. Il enclenche une surenchère de lois et de proclamations fustigeant l’« angélisme » ou le « laxisme » et appelant à un durcissement répressif, y compris au sein des partis traditionnellement plus favorables à la prévention et à la défense des libertés. En autonomisant la sécurité par rapport à la question sociale dans laquelle elle était jadis encastrée, cette dynamique a profondément reconfiguré les cadres d’analyse et les logiques de fonctionnement de la justice, de la police, mais aussi de l’école ou des services sociaux (3). En conséquence, les prisons se sont remplies au-delà de leur capacité d’accueil (85 000 personnes détenues en France au 1er juillet 2025, pour 62 509 places) (4), sans que l’on observe un quelconque effet sur la baisse de la criminalité ni que cet échec produise une inflexion des discours publics. Mais là n’est peut-être pas l’enjeu. Le tournant punitif est aussi une dramaturgie dans laquelle les mots comptent plus que les actes et l’annonce de lois ou de réformes plus que leurs conséquences réelles. Avec la complicité intéressée de médias, elle valorise les postures martiales et aiguise les compétitions entre professionnels de la politique cherchant à apparaître plus « durs » que leurs homologues. Elle oblige également — c’est le propre des dramaturgies — à renouveler régulièrement les « menaces » à l’ordre social ou national. Après les « bandes », la « violence des mineurs », la « radicalisation », il semble que ce soit désormais le tour du« narcotrafic ». « Submersion, c’est l’image qui s’impose pour décrire le phénomène auquel la France est confrontée, s’inquiète un récent rapport d’enquête sénatorial. Plus aucun territoire, plus aucune catégorie sociale ne sont épargnés. Le trafic s’infiltre partout, avec pour corollaire une violence exacerbée. Les scènes de guerre vécues par certains habitants contribuent à ce qu’il est possible d’appeler un “narcoterrorisme” car elles installent un climat de peur et d’insécurité constant pour l’ensemble des habitants (5). »
M. Bruno Retailleau, alors ministre de l’intérieur, avait renchéri : « Il y a un tsunami blanc qui déferle sur la France » (Le Monde,22 août 2025). Quelques mois plus tôt, il assénait déjà : « Les narcoracailles sont partout. Il va falloir les combattre avec une détermination implacable. (…) Le choix que nous avons aujourd’hui est celui d’une mobilisation générale ou alors la mexicanisation du pays » (Le Parisien, 1er novembre 2024). Soucieux de ne pas être en reste, le ministre de la justice Gérald Darmanin annonce
que les « cent plus gros narcotrafiquants » doivent être isolés dans « une prison de haute sécurité » (LCI, 12 janvier 2025).
Sur le modèle américain
>> Novembre 2025, pages 1, 20 et 21, en kiosques
En termes simples, « le danger est à nos portes », écrivent les sénateurs, complaisamment relayés par une multiplicité de « unes », de reportages et de dossiers spéciaux dans les médias généralistes. Il serait urgent de réagir, et c’est l’objet de la loi « visant à sortir la France du piège du narcotrafic », promulguée le 13 juin 2025. Elle crée notamment un parquet national anticriminalité organisée (Pnaco), sur le modèle du parquet national antiterroriste (PNAT) et des quartiers de lutte contre la criminalité
organisée dans deux centres pénitentiaires (celui de Vendin-le-Vieil, inauguré en juillet 2025, et celui de Condé-sur-Sarthe). Elle renforce le statut de « repenti », les mesures de gel et de saisie des biens criminels ainsi que les possibilités de répression pénale et administrative. Elle élargit également les techniques spéciales d’enquête des services de police, au point que le Conseil constitutionnel a dû censurer les dispositions concernant la surveillance numérique et algorithmique, jugées trop attentatoires à la
vie privée. Parallèlement, l’Office anti-stupéfiants (Ofast), créé en 2019 pour coordonner la lutte contre le trafic, voit son rôle et ses effectifs étoffés, le rapport sénatorial proposant même de le transformer en une « DEA [Drug Enforcement Agency] à la française », sur le modèle américain. L’ampleur de cette campagne politico-médiatique ne manque pas de surprendre l’observateur de ce que l’on nommait jusqu’ici la « lutte contre le trafic de stupéfiants ». Car ce glissement sémantique n’est pas neutre. L’expression « narcotrafic » convoque un imaginaire lié à la situation latino- américaine, popularisé par des séries à succès (Narcos, El Chapo) ou des films comme Traffic
(2000), de Steven Soderbergh. Dans celui-ci, des cartels fortement organisés, hiérarchisés et armés disputent à l’État des portions
complètes de son territoire et sont en lutte pour le monopole de la production et de la commercialisation de la drogue, usant simultanément de la violence et de la corruption. La comparaison est caricaturale. Le taux d’homicide est vingt fois moins important en France qu’au Mexique ou en Colombie (1,3 pour 100 000 habitants en 2023, contre 24,9 dans les deux pays), et en baisse constante, puisqu’il a été divisé par deux depuis 1990 (6). Les « règlements de comptes entre malfaiteurs » ne représentent
que 9 % des 900 victimes enregistrées annuellement (7).
La rhétorique alarmiste des pouvoirs publics constitue peut-être une manière maladroite d’attirer l’attention sur la place qu’occupent désormais les stupéfiants dans notre société. Selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), la proportion de personnes de 18 à 75 ans ayant expérimenté le cannabis dans leur vie est passée de 12,7 % en 1992 à 50,4 % en 2023 (8). Pour la cocaïne, on est passé de 5,6 % en 2017 à 9,4 % en 2023. L’usage d’héroïne reste relativement stable (2 % en 2023) et les drogues de synthèse progressent : en 2023, MDMA, 8,2 % ; amphétamines, 4,3 % ; et poppers, 14,9 %. Il s’agit donc d’un phénomène massif qui touche tous les milieux, des intérimaires ou des étudiants aux députés et aux dirigeants d’entreprise.
Toutefois, les mesures mises en place par les ministres et les parlementaires, comme leurs analyses, reposent sur deux présupposés erronés : l’assimilation des marchés de la drogue au « crime organisé » et la focalisation sur les vendeurs, au détriment des consommateurs.
Le trafic de stupéfiants, comme nombre d’activités criminelles, nécessite incontestablement de l’organisation. Mais le niveau et l’ampleur de cette organisation sont difficiles à déterminer. Les sources restent rares et les commissions d’enquête parlementaires, comme la presse, reprennent sans distance les informations transmises par les services de police. Or ces derniers ont une tendance systématique à exagérer la menace qu’ils combattent. « Il faut grossir les traits si l’on veut que les choses passent et soient entendues », reconnaissait en entretien un commissaire de police. On perçoit les profits immédiats qu’ils peuvent en tirer en matière de légitimité, de prestige ou de renforcement de moyens humains, techniques et légaux. Ceci est particulièrement vrai pour les institutions les plus récentes et les moins assurées administrativement. Le cas de la note de l’Ofast intitulée « État de la menace liée aux trafics de stupéfiants » et parue en juillet 2025 est instructif. Elle présente l’« organisation du marché français », avec moins de 100 « grands importateurs », 5 000 « semi-grossistes » et 200 000 personnes impliquées dans des « réseaux locaux et des points de deal ». Elle détaille ensuite les revenus quotidiens : « coursier et serveur », de 20 à 30 euros, « ravitailleur, coupeur, guetteur, rabatteur », de 50 à 100, et « vendeur et banquier », de 50 à 250. Quoique estampillée « diffusion restreinte », elle a filtré dans Valeurs actuelles, et Le Monde du 5 août 2025 a jugé bon d’y consacrer sa « une » (« Drogue : des réseaux de plus en plus
menaçants »), ainsi qu’une double page, infographies à l’appui. Une fuite bien opportune. Quelques jours plus tôt, le siège de l’Ofast avait été perquisitionné par l’inspection générale de la police nationale (IGPN), à la suite du fiasco d’une opération de « livraison contrôlée » — 400 kilos de cocaïne ont disparu dans la nature — qui avait conduit à la mise en examen de plusieurs fonctionnaires de l’antenne marseillaise. Mais qu’importe, le monopole policier de la production des données, couplé à la force
magique que leur confère le secret qui les entoure, semble dispenser de tout questionnement sérieux sur leurs conditions de production et de circulation.
Pour approcher les organisations et les marchés criminels, une autre option consiste à utiliser le matériau recueilli par les investigations policières, mais en le réinterprétant au prisme des sciences sociales. Ainsi l’économiste américain Peter Reuter s’est-il basé sur les preuves saisies lors de perquisitions, les comptes rendus d’écoutes téléphoniques, les interrogatoires des suspects, ainsi que sur des entretiens avec des procureurs, des enquêteurs et des informateurs pour comprendre le fonctionnement de la Mafia dans les années 1960-1970. À l’époque, cette dernière est considérée comme la clé de voûte du crime organisé. Dans son
rapport de 1967, la President’s Commission on Law Enforcement and the Administration of Justice la décrit comme « une société
qui implique des milliers de criminels travaillant avec des structures aussi complexes que celles de n’importe quelle grande entreprise, soumises à des lois plus rigoureuses que celles des gouvernements légitimes (9) ». Dans les paris hippiques et sportifs, les loteries illégales et les prêts usuraires, la Mafia aurait conquis une position prééminente en écartant violemment ses concurrents et en pratiquant la corruption (des policiers, des élus et des fonctionnaires locaux). L’ouvrage de Mario Puzo Le Parrain, publié en 1969, et le film de Francis Ford Coppola qui en est tiré en 1972 résument bien ces représentations. « Crime désorganisé » Or le travail de Reuter montre une autre réalité, celle d’un univers morcelé dans lequel les tentatives de monopolisation sont vouées à échouer. En effet, les organisations criminelles ne sont précisément pas des entreprises conventionnelles. D’une part, elles reposent avant tout sur de puissants liens interpersonnels, forgés dans des expériences communes (l’enfance dans un quartier, la migration, l’incarcération, etc.). Mais cette force représente une faiblesse dès que la taille s’accroît. La redistribution des honneurs, des places et des bénéfices n’étant pas codifiée ni contractualisée, elle peut rapidement apparaître comme injuste et arbitraire. La loyauté au groupe s’affaiblit également à mesure que l’on s’éloigne du noyau central. Ces deux facteurs se combinent pour produire une tendance permanente au « factionnalisme », c’est-à-dire à l’éclatement en entités concurrentes, qui s’accompagne parfois de poussées de violence autophage. D’autre part, la croissance d’un groupe criminel attire inévitablement l’attention de la police et de la justice. Les enquêtes et les arrestations éventuelles le déstabilisent immanquablement. Elles exacerbent les compétitions et les querelles internes pour les positions de pouvoir, qui là encore poussent à la division en factions.
L’analyse de Reuter trouve une résonance dans les travaux portant sur les « cartels globaux » de la drogue, notamment mexicains et colombiens. Le chercheur Oswaldo Zavala a montré comment, dans un contexte de redéfinition de la doctrine de sécurité nationale des États-Unis, le « narco-récit » s’était progressivement imposé comme une rationalité gouvernementale unifiant des réalités hétérogènes (lire « Brève généalogie du « narcotrafic »). C’est ainsi que l’on peut comprendre la valse de « chefs des chefs » (« El Chapó », « El Mayo », « El Mencho », etc.) et le renouvellement permanent de la « principale organisation » (le cartel « de
Sinaloa » puis « Jalisco Nouvelle Génération » ou « Santa Rosa de Lima »). Comme l’explique Gilberto Rodríguez Orejuela, un trafiquant colombien : « Le “cartel de Cali” n’existe tout simplement pas. C’est une invention de la DEA. (…) Il y a plusieurs groupes, pas un seul cartel. La police le sait. La DEA aussi. Mais ils préfèrent inventer un ennemi monolithique. » Un représentant du « cartel de Medellín » abonde dans le même sens : « Les cartels n’existent pas. Ce qui existe, c’est un ensemble de trafiquants de
drogue. Parfois, ils travaillent ensemble, parfois non. Les procureurs américains les appellent “cartels” pour faciliter leurs affaires » (10). Ces procureurs en retirent effectivement une plus grande notoriété, mais peuvent également accréditer la croyance selon laquelle un « coup définitif » a été porté au marché des stupéfiants, alors qu’il s’apparente plutôt à un « puits sans fond » ou à un « tonneau des Danaïdes », pour reprendre des expressions souvent utilisées par des policiers.
Si la « mafia » italo-américaine ou les « cartels » latino-américains constituent des artefacts, que dire de la situation en Europe ?
Là aussi, il existe d’autres explications que les analyses policières. En interrogeant près de quatre cents criminels de la ville de Gênes, les sociologues italiens Alessandro Dal Lago et Emilio Quadrelli dessinent un monde illégal instable et fragmenté de petits entrepreneurs d’origines diverses, qui opèrent en fonction des publics auxquels ils ont accès (communautés migrantes, étudiants, cadres supérieurs, etc.), des produits qu’ils vendent et des réputations qu’ils ont pu se construire (11). Il en va de même en France, où les réseaux d’importation et de distribution associent des milieux, des catégories ou des groupes d’individus qui constituent
« plus des cliques ou des grappes qu’un milieu homogène (12) ». Ce que confirme en entretien un policier : « Ce sont des PME [petites et moyennes entreprises] de la drogue. On en fait tomber une, et le lendemain il y en a une autre. »
Ce constat est d’ailleurs implicitement partagé par la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
de 2000, selon laquelle « “groupe criminel organisé” désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves (…) pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ». Difficile d’adopter une définition plus étendue et d’avaliser davantage la justesse de l’expression « crime désorganisé » (disorganized crime) forgée par Reuter.
Face à cette situation, que penser des dispositifs « exceptionnels » annoncés à grand renfort de publicité par les ministres de l’intérieur et de la justice ? Les unités spécialisées et les structures ad hoc donnent l’impression d’une réponse publique énergique.
Mais elles sont toujours constituées au détriment des institutions de droit commun. Faut-il des prisons « de haute sécurité » à l’heure où des directeurs de l’administration pénitentiaire multiplient les lettres ouvertes pour décrire un système « au bord de la rupture » en raison de la sur-incarcération ? Faut-il un parquet spécialisé quand les autres croulent sous les affaires que les durcissements pénaux successifs les contraignent à poursuivre ? Faut-il renforcer l’Ofast lorsque la réforme de la police judiciaire affaiblit ses capacités d’enquête et provoque une crise des vocations de la filière investigation ?
Ces mesures comme le « narco-récit » qui les accompagne laissent curieusement de côté la consommation des stupéfiants. Son ampleur implique pourtant de reconnaître que pour nombre d’usagers, la drogue constitue quelque chose d’agréable, de récréatif, et qu’elle offre un additif à leur existence. Dire cela n’implique pas de cautionner le recours aux stupéfiants, mais le nier ou l’ignorer sont profondément hypocrites. L’alcool et le tabac relèvent de la même logique, et ce ne sont pas les politiques répressives qui ont pu réduire leur place dans la vie quotidienne. Il suffit de penser à l’échec complet de la « prohibition » imposée aux États-
Unis entre 1920 et 1933. Au contraire, ce sont des mesures de santé publique, mêlant campagnes de prévention et de sensibilisation, aide sociale et médicale pour les personnes en situation d’addiction et régulation plus stricte (sur la publicité, les espaces publics, etc.) qui ont permis de freiner la consommation ou de la rendre plus raisonnée. En France, la part des buveurs hebdomadaires est ainsi passée de 62,6 % en 2000 à 39 % en 2021, et celle des adultes consommant de l’alcool tous les jours de
23,9 % en 1992 à 8 % (13). Quant au tabac, les fumeurs quotidiens sont passés sur la même période de 30 % à 25,3 % (14).
Aucune leçon ne semble en être tirée dans le débat actuel. Dans les 629 pages du rapport sénatorial précité, le mot « médecin » ne figure qu’une fois, et seule une recommandation floue préconise d’« engager un véritable effort de communication publique .
LAURENT BONELLI
Professeur de science politique à l’université Paris Nanterre.
(1) Karl Marx, Théories sur la plus-value, Les Éditions sociales, Paris, 2024.
(2) Émile Durkheim, Les Règles de la méthode sociologique, Presses universitaires de France, Paris, 1996. narcotrafic et [d’]améliorer la prise en charge des consommateurs ». Pourtant il existe de nombreux exemples d’action publique en la matière. Des pays comme l’Allemagne, le Canada, l’Espagne, l’Uruguay ou des États américains (Colorado, Washington, Oregon) ont légalisé l’usage récréatif du cannabis, essayé d’en encadrer la production et mis en place des accompagnements efficaces.
La focalisation sur l’offre a également pour conséquence de produire une représentation faussée des trafiquants. Celle-ci est en effet construite à partir de ceux qui sont les plus exposés au regard policier, c’est-à-dire les jeunes hommes des milieux populaires, souvent racisés. Bien sûr, le renoncement à toute ambition nationale de transformation des quartiers défavorisés, le tarissement des financements publics comme l’essoufflement du tissu associatif et des services sociaux et éducatifs accroissent la place de l’économie illégale. Bien sûr, les liens familiaux élargis que certains entretiennent avec le Maroc et la région du Rif, grosse productrice de cannabis, facilitent la mise en place de réseaux d’approvisionnement et de distribution. Mais ces éléments sont loin d’épuiser la question des marchés de la drogue. Dal Lago et Quadrelli montrent ainsi que la cocaïne emprunte des circuits différents en fonction du public visé. Dans leur enquête à Gênes, ce sont plutôt des Nigérians qui vendent dans la rue et des Albanais dans les bars à hôtesses du port. Mais qui approvisionne ceux qu’ils appellent les « gens comme il faut », plus exigeants sur la qualité du produit et moins regardants sur le prix ? Des individus insérés dans ces milieux et qui s’y meuvent avec aisance. Il en va de même pour les drogues de synthèse (comme l’ecstasy), faciles à fabriquer et distribuées par « des habitués de discothèques, capables d’interpréter la soirée ». Et l’essor des nouvelles technologies de communication a démultiplié les possibilités de relations directes entre vendeurs et consommateurs, diversifiant leurs profils.
Les clubs nocturnes, les soirées étudiantes ou mondaines et les échanges numériques restent bien moins exposés à la répression que la revente de rue, qui fournit par conséquent le gros des délinquants identifiés par la police et la justice. Ainsi se forgent des stéréotypes en apparence incontestables sur les figures des dealers. Figures que certains acteurs politiques, journalistes ou experts s’emploient ensuite à radicaliser, en transformant des dynamiques contingentes (comme la formation de groupes affinitaires dans un quartier ou dans l’expérience migratoire) en propriétés « culturelles », qu’ils attribuent sans distinction à des communautés supposées inintégrables.
Sous bien des aspects, les représentations dominantes du « narcotrafic » (ou plus prosaïquement du trafic de drogue) constituent ce que le sociologue Pierre Bourdieu appelle une « illusion bien fondée (15) ». C’est-à-dire une fiction, trompeuse mais solide car elle est produite et reproduite par l’État et bénéficie de moyens constants pour exister et subsister. Les « bénéfices secondaires » qu’elle fournit sont évidents, mais ils apparaissent bien étriqués, égoïstes et inefficaces face à l’enjeu que représentent les drogues dans notre société.